 1905 : Limoges se couvre de barricades
1905 : Limoges se couvre de barricades
Le vendredi 14 avril 1905, quelques centaines d’ouvriers et ouvrières de la porcelaine partent faire la tournée des usines de Limoges, fermées par les patrons qui ont décidé de réduire à la famine une population ouvrière trop offensive. Pour résister à l’intervention de l’armée, des barricades sont dressées. La lutte, essentiellement dirigée contre l’arbitraire patronal, prend un tour que la presse qualifie de « révolutionnaire ».

Les photographies de l’évènement sont imprimées en carte postale dès l’été 1905.
La tension monte depuis quelques années à Limoges, « la Rome du socialisme » qui a été de toutes les révolutions du XIXe siècle et où s’est tenu le congrès de fondation de la CGT en 1895. Depuis 1900, le syndicalisme prend de l’ampleur, encouragé par des grèves, souvent victorieuses.
L’Initiative donne le ton
En avril 1902, dans le secteur de la porcelaine, qui occupe près de 13 000 ouvriers et ouvrières, une grève de près de deux mois accroît le prestige de l’Initiative, le plus ancien et plus important syndicat du secteur, affilié à la CGT. Les fabricants ont tenté d’imposer une hausse de la production pour compenser la baisse du temps de travail imposée par la loi des dix heures, votée en 1900.
Face à la grève décrétée par l’Initiative, l’Union des fabricants répond par le lock-out et met au chômage des milliers d’ouvriers. Mais du côté patronal, l’unité se fissure : certaines usines rouvrent rapidement pour profiter du contexte international favorable aux exportations. Les ouvriers et ouvrières de ces usines travaillent et cotisent à une caisse de grève. Les grévistes bénéficient des caisses de chômage des syndicats des divers métiers de la porcelaine et des aides de la mairie socialiste. L’Union des fabricants doit mettre fin à son lock-out, acceptant la victoire de l’Initiative, qui enregistre alors 300 adhésions en quelques mois.
Les grèves se multiplient les années suivantes dans divers secteurs (porcelaine et chaussure notamment) , notamment des grèves de solidarité avec des mouvements dans d’autres villes, ce qui indique un haut degré de conscience de classe. En 1904, douze grèves ont lieu, presque toutes victorieuses, et l’année 1905, commence avec seize grèves entre janvier et mai. Les syndicats fédérés dans la CGT ont alors triplé leur nombre d’adhérents en dix ans. Avec 6 000 membres, la CGT comprend alors 20 % de la population ouvrière de la ville, dont 2 600 travaillent dans la porcelaine. Les femmes comptent pour 42 % des syndiqués de ce secteur, où elles représentent 40 % des emplois.
Le 10 février 1905, alors qu’une grève des cordonniers de l’usine Monteux vient de s’achever, un grand meeting rassemble 600 personnes à la bourse du travail pour écouter Auguste Delalé, secrétaire du syndicat parisien des cordonniers. Anarchiste, ancien gérant du Père peinard d’Émile Pouget, plusieurs fois incarcéré pour des articles dans la presse libertaire, il fait entendre un discours offensif, incitant à la solidarité entre les corporations, notamment par l’usage de la grève générale.
Si les groupes anarchistes locaux, proche de l’individualisme et de l’illégalisme, jouent un rôle marginal dans les événements, beaucoup de libertaires sont surtout actifs dans les syndicats et propagent notamment l’idée de grève générale. Cette stratégie, qui s’impose alors dans toute la France à la CGT, est défendue à Limoges depuis 1902 par Jacques Tillet, secrétaire de l’Initiative. Tillet n’est pas anarchiste mais socialiste allemaniste [1]. Étonnamment, la grève générale est aussi soutenue par les plus radicaux des guesdistes, comme entraînement à la révolution, et donc adoptée au congrès de la CGT de Limoges en 1903.
L’agitateur étranger
Trois jours après le meeting de Delalé, une nouvelle grève démarre dans l’une des usines de chaussures Fougeras. Il n’en faudra pas plus pour que la presse bourgeoise accuse Delalé d’en être à l’origine, de même que pour les conflits suivants. En fait, les ouvriers et ouvrières de Fougeras demandent une augmentation de salaire, mais surtout le renvoi du directeur, de quelques contremaîtres particulièrement autoritaires et d’ouvriers étrangers amenés par le patron lors d’une précédente grève. L’ensemble des cadres exige du patron qu’il ne cède pas et des manifestations sont alors organisées devant les domiciles du patron et de deux des contremaîtres incriminés. Le 18 février, ceux-ci quittent Limoges pour Paris et remettent leurs biens sous la protection de la police.
Les manifestations se rendent alors devant d’autres usines ; où souvent les ouvriers et ouvrières en profitent pour demander le départ de cadres autoritaires et particulièrement zélés dans la répression antisyndicale. À l’usine Denis et Lecointe, la directrice de l’atelier des mécaniciennes, Joséphine Prébosc est molestée car elle a empêché la souscription en faveur des grévistes de Fougeras.
Les meetings tenus par les grévistes font émerger de nouvelles revendications contre les contremaîtres qui généralement embauchent eux-mêmes les ouvriers, puis les rétribuent avec un revenu donné par le patron selon le travail effectué. Le partage de ce revenu se fait bien sûr à l’avantage du contremaître. Cette double exploitation apparaît de plus en plus insupportable. Il faudra attendre le 1er avril pour que Fougeras, récemment rentré à Limoges, accepte de « placardiser » son contremaître le plus haï. Le travail devrait reprendre le 6 avril.
Embrasement général
Pendant ce temps-là, divers mouvements se sont amorcés : le 25 mars, chez Beaulieu (usine de feutres à chapeau), la grève vise à une augmentation de salaire, une baisse du temps de travail et au renvoi d’une contremaîtresse. Le 28 mars, chez Théodore Haviland (l’une des plus grosses usines de porcelaine, fondée par l’américain David Haviland en 1842), les peintres font grève contre le licenciement de trois d’entre eux jugés peu productifs puis contre le « droit de cuissage » que s’arroge le contremaître Penaud. Haviland soutient sans réserve Penaud et refuse de recevoir les grévistes. Le 2 avril, la maison de Penaud est caillassée. Le 8 avril, la grève s’étend chez les mécaniciens de l’usine Charles Haviland (le frère de Théodore), pour obtenir le renvoi du contremaître Sautour, militant catholique, qui avait licencié un ouvrier coupable d’avoir fait enterrer civilement sa fille de 5 ans. Puis, ce fut le tour des typographes le 8 avril.
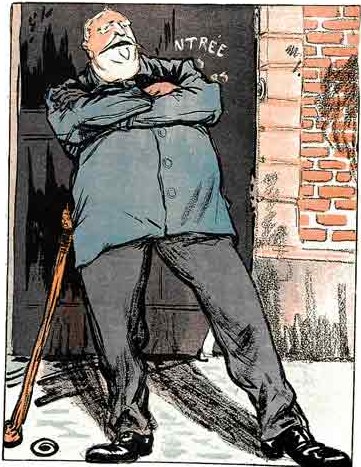
Devant la crainte de l’embrasement, la réponse du patronat est le lock-out : le 13 avril, les vingt et une usines de porcelaine sont fermées, les 13 000 ouvriers et ouvrières sont mis au chômage (alors que près de 10 000 étaient déjà en grève). Les patrons sont décidés à ne plus céder. La multiplication des défilés en ville, au son de L’Internationale, derrière le drapeau rouge et le drapeau noir, leur font craindre une remise en cause irrémédiable de leur autorité. De plus, l’armée est de plus en plus ciblée par les slogans des grévistes : l’accueil du général Tournier, nouveau commandant de la région militaire et militant catholique, le 14 mars, a tourné à la manifestation antimilitariste, au point que le général a dû se réfugier dans la Banque de France pour échapper à la foule.
L’insurrection
Dès le lendemain, à l’aube, 400 à 500 grévistes de l’usine Guérin, président de l’Union des fabricants, décident d’aller voir si leurs chefs ne seraient pas en train de préparer des commandes, histoire de continuer à gagner de l’argent pendant le lock-out. Le portail de l’usine est enfoncé. La police municipale, notamment composée d’anciens ouvriers au chômage et d’anciens syndicalistes, négocie leur départ.

C’est alors au tour de l’usine Jouhanneaud, puis de Lanternier, de Barnardaud et enfin de la grande usine Charles Haviland, qui est envahie et décorée du drapeau rouge. L’arrivée de Théodore Haviland, dans sa voiture, provoque la colère : la voiture est poursuivie, aux cris de « Mort au voleur ». Le patron doit se réfugier dans l’usine. Vers 16 heures, la foule a grossi, et ce sont plus de 1 200 ouvriers et ouvrières qui prennent d’assaut l’usine, chassent la police qui la gardait, brûlent la voiture mais pas le drapeau américain, bien protégé par la police. Après avoir hué le patron, la foule quitte l’usine et continue sa tournée jusqu’à l’usine Touze, lorsque le 21e régiment de chasseurs à cheval charge, sans sommation.
On résiste à coup de pierres, on construit des barricades avec ce que l’on trouve (des rails, un tramway renversé, un cheval mort...). Mais la nuit met fin aux affrontements et les barricades sont abandonnées. Les soldats qui s’apprêtaient le lendemain à charger pour reprendre la place en sont réduits à faire du nettoyage urbain. L’affaire a fait suffisamment peur pour que les autorités déploient les grands moyens : dans la nuit, le préfet retire au maire ses pouvoirs de police, Théodore Haviland hisse le drapeau américain sur sa villa et réclame, vainement, de l’aide à l’ambassade américaine.

Le samedi 15 avril, une manifestation menace de prendre d’assaut la prison pour libérer les prisonniers de la veille. Mais c’est finalement une statue de saint Joseph qui sera brisée, avant que les chasseurs à cheval ne chargent à nouveau, toujours sans sommation. Le lendemain, la tension est à son comble : on apprend que trois armureries ont été dévalisées dans la nuit et qu’une bombe a explosé devant le domicile d’un directeur d’usine. La presse évoque déjà le retour des attentats anarchistes. C’est le dimanche des rameaux mais les églises sont bien vides. Par contre les trains amènent quelques centaines de gendarmes supplémentaires. Le préfet annonce dans l’après midi l’interdiction de toute manifestation.
La force des armes
Le lundi, plus de 3 000 personnes se rassemblent pour un meeting d’Albert Lévy, trésorier de la CGT. Mais dans la nuit, plusieurs ouvriers ont été arrêtés, accusés d’avoir caché des armes... que la police n’a pas trouvées. La foule, toujours munie d’un drapeau noir et d’un drapeau rouge, prend donc le chemin de la préfecture pour demander leur libération dès le début de l’après-midi. Le préfet ne répond que vers 18 heures : le ministre de l’Intérieur refuse la libération.
À 19 heures, plus de 5 000 personnes attaquent la prison. Mais à peine la porte enfoncée, les sinistres chasseurs à cheval, renforcés par des dragons, chargent, sabre au clair. Plus de deux heures d’affrontement suivent, dans tout le quartier. Des dizaines de barricades sont dressées sommairement mais sont peu efficace face aux 1 200 militaires. Beaucoup d’ouvriers et d’ouvrières se réfugient au jardin d’Orsay, dont les pentes paraissent trop raides pour permettre à la cavalerie de charger. Des pierres et des bouteilles pleuvent sur la place du champ de foire, en contrebas du jardin, occupée par l’armée. La nuit est tombée et l’éclairage public a été brisé par les manifestants et manifestantes.
L’infanterie décide alors de nettoyer le jardin de la façon la plus barbare : l’ordre est donné de tirer sur le jardin complètement plongé dans le noir ; 52 balles sont tirées. En quelques minutes, le jardin se vide et les rues alentour aussi. Vers 22 h 30, la nouvelle se répand : il y a un mort. Camille Vardelle, ouvrier porcelainier de 19 ans, a été mortellement blessé par balle. L’hôpital déclare deux autres blessés par balle et un blessé grièvement touché à la tête par un coup de sabre. Tous ont moins de 20 ans.
L’ordre des cimetières règne
Le mardi matin, l’ordre règne : quelques curieux se rassemblent sur la place du champ de foire, aussitôt l’armée charge. Mais mercredi 19 avril, plus de 10 000 personnes sont présentes à l’enterrement de Vardelle : il faut deux chars funéraires pour transporter toutes les couronnes en hommage « à la victime du régime capitaliste », « à notre frère assassiné le 17 avril par les balles françaises ». Ce jour-là, des centaines de demandes de protection affluent chez le préfet : tout ce que la ville compte en patrons en tous genres craint une vengeance. Dans les semaines qui suivent, les soldats évitent de se déplacer seuls en ville.

Les négociations reprennent rapidement et dès le 21 avril un accord est trouvé : le contremaître Penaud est renvoyé, mais pas Sautour. Les salaires ne sont pas augmentés mais les grévistes sont tous réembauchés.
Les grèves qui suivront les mois suivants seront rarement victorieuses : une discipline militaire est restaurée dans les usines et beaucoup d’ouvriers et d’ouvrières sont encore au chômage du fait du ralentissement de la production. Par contre, la manifestation du 1er mai rassemble plus de 4 000 personnes et les rassemblements ou manifestations se multiplient en hommage aux victimes de la grève : la police et l’armée sont systématiquement repoussées lorsqu’elles tentent de les empêcher. Les rumeurs sur l’armement des syndicalistes et les hordes anarchistes tourneront encore longtemps, pour discréditer le mouvement syndical, mais permettront aussi occasionnellement de calmer les ardeurs de certains patrons.
Loin d’être aussi révolutionnaire que la droite voulait bien le dire, cette grève a tout de même illustré la forte conscience de classe, la volonté ouvrière de maîtriser l’espace de la ville et de s’imposer face à des cadres souvent tyranniques. Il aura fallu l’usage de la force armée pour y mettre fin, mais sans entamer durablement la combativité ouvrière : le 30 juillet 1914, veille de l’assassinat de Jaurès, il y a encore 5 000 à 7 000 personnes qui manifestent à Limoges contre la guerre.
Renaud (AL Alsace)






