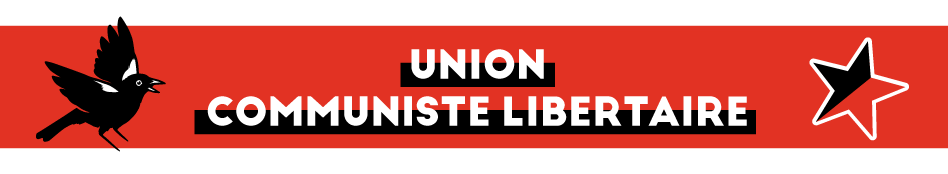Dossier Révolution haïtienne : Saint-Domingue, la colonie la plus lucrative du monde
Dossier Révolution haïtienne : Saint-Domingue, la colonie la plus lucrative du monde

Surnommé « la perle des Antilles », Saint-Domingue est devenue, dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, le modèle le plus achevé d’« île à sucre » façonnée par le capitalisme européen.
Véritable machine à cash pour le royaume de France, c’est sa colonie la plus productive, et la pièce maîtresse de son commerce transatlantique : les deux tiers des navires appareillés en France sont à destination de l’île. Saint-Domingue pèse à elle seule 50% de la production mondiale de sucre et de café, qui, exportés en majeure partie vers la métropole, sont ensuite redistribués dans toute l’Europe, au grand dam des concurrents britanniques de la Barbade et de la Jamaïque. Saint-Domingue est également la première exportatrice mondiale de coton, et produit encore de l’indigo, du tabac et du cacao. Dans les années 1780, son commerce extérieur, évalué à plus de 300 millions de livres tournois, est l’équivalent de celui des États-Unis.
Le secret de cette prospérité se nomme « économie de plantation » : un système d’agriculture d’exportation, fondé sur l’exploitation intensive d’une main d’œuvre esclavisée au sein de grands domaines (dits « habitations ») rationalisés à l’extrême. Dans ces bagnes, des centaines de milliers d’Africaines et d’Africains triment sous le fouet six jours sur sept, de douze à seize heures par jour, travaillant même de nuit pendant les récoltes. En raison du surmenage, la mortalité est deux fois supérieure à la natalité, ce qui oblige à une importation constante de main d’œuvre : dans les années 1780, chaque année, 30.000 à 40.000 esclaves achetés aux marchands africains sont débarqués à Saint-Domingue.
À la veille de la Révolution française, la colonie présente ainsi la plus forte concentration d’esclaves au monde (près de 90% de sa population), composées aux deux tiers de primo-arrivantes. L’économie de plantation ne se relèvera jamais des destructions de l’insurrection de 1791.
Guillaume Davranche (UCL Montreuil)
Les autres articles du dossier
- Édito : Ci-gît l’esclavagisme
- 1791-1792 : Le bris des chaînes, le feu à la plaine
- 1792-1793 : S’allier aux impérialistes pour les battre
- 1793-1796 : L’irrésistible ascension de Toussaint Louverture
- 1796-1801 : Le legs maudit des grandes plantations
- 1802-1803 : Les sentiers tortueux de la guerre d’indépendance
- Sudhir Hazareesingh (historien) : « L’abolition de 1793 a été imposée par les révolutionnaires noirs »
- Épilogue 1804-1825 : Face à l’impérialisme, défier ou concilier ?