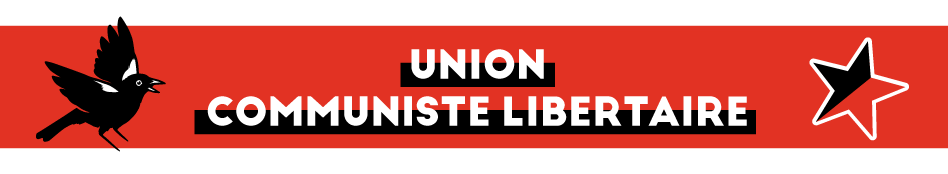L’AIT parisienne en ordre dispersé
L’AIT parisienne en ordre dispersé
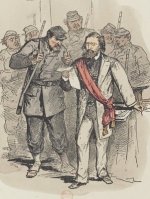
Plus d’un quart des élus à la Commune sont issus de l’Association internationale des travailleurs (la « Première Internationale »). Mais, leurs vues sont loin d’être unifiées, et leur impulsion politique n’est pas coordonnée.
« La bataille de Paris est finie. [...] Mais la lutte continue. Une puissance occulte et collective [...] qui s’appelle aujourd’hui l’Association internationale des travailleurs appelle plus ouvertement que jamais les prolétaires de tous les États à une nouvelle prise d’armes. »
La pléthorique littérature anticommunarde est caractérisée par cet imaginaire du complot qui prête à une « puissance occulte », forcément étrangère, la responsabilité de l’insurrection. La réalité est tout autre. Engels a relevé ce paradoxe que la Commune était spirituellement « fille de l’Internationale bien que l’Internationale n’ait pas remué le petit doigt pour la faire ».
Affaiblie par plusieurs procès et grandes grèves en 1869-1870, l’AIT n’est pas au mieux de sa forme quand la guerre de 1870 éclate. Si les adhésions parisiennes augmentent après la chute de l’Empire grâce au ralliement des blanquistes, les divisions s’exacerbent en parallèle.
Parmi les fondateurs français de l’AIT, Tolain et Fribourg s’en sont écartés dès 1869, quand le congrès de Bâle a adopté les principes collectivistes. Ces « proudhoniens étroits » rallient alors le parti de l’ordre, et Fribourg dénonce même « les crimes commis dans Paris par une poignée de misérables, rebuts de tous les partis et de toutes les classes sociales ». Mais un autre proudhonien de l’AIT, Pierre Denis, ami de Jules Vallès, donne la tonalité décentralisatrice et fédéraliste de la Commune dans la « Déclaration au peuple français » du 19 avril 1871.
Contre le Comité de salut public
Dans le bouillonnement qui voit surgir la Commune, l’AIT parisienne est plutôt atone, et c’est davantage à titre individuel que ses militants rallient le Comité central de la garde nationale ou le Comité central républicain des vingt arrondissements. Mais l’AIT parisienne reprend du poil de la bête en vue des élections du 26 mars au conseil de la Commune. Son manifeste appuie la « révolution communale » qui doit « fournir à chaque citoyen les moyens de défendre ses droits [...] et de déterminer l’application progressive des réformes sociales ». Elle obtient 23 élus sur 92. Parmi eux, Eugène Varlin, Albert Theisz ou encore le Hongrois Léo Frankel portent haut le volet social de la Commune – notamment avec le décret visant à la reprise des ateliers vacants par des associations ouvrières.
Début mai, on retrouve les éléments les plus notables de l’AIT – hormis la quasi totalité des blanquistes – dans l’opposition au comité de salut public, contre lequel ils défendent l’action révolutionnaire sans recours à la dictature. Bakounine évoque leur « situation excessivement difficile » : « Ne se sentant pas suffisamment soutenus par la grande masse de la population parisienne – l’organisation de l’Association internationale, très imparfaite elle-même d’ailleurs, n’embrassant à peine que quelques milliers d’individus –, ils ont dû soutenir une lutte journalière contre la majorité jacobine. »
Tandis que dans la coulisse sa lutte contre Bakounine est déjà engagée, Karl Marx rédige en juin 1871, à Londres, l’Adresse du conseil général de l’AIT, passé à la postérité sous le nom de La Guerre civile en France. Ce panégyrique, où Marx critique lui-même le principe étatique, contribuera largement au rayonnement de la Commune au sein du mouvement ouvrier international.
Mathieu Léonard
Les autres articles du dossier
Crise prérévolutionnaire
Chronologie commentée
- 18 mars-28 mai : De la révolte montante à l’ultime barricade
Mémoire politique
- Quand les libertaires prenaient leurs distances
- Pour l’anarchiste Jean Grave, « La Commune légiférait, mais agissait peu »
- Gustave Lefrançais (1826-1901), entre communalisme et anarchisme
- La postérité internationale de l’idée de « commune »
Pouvoir populaire
- Commune, comités de quartiers, une dialectique inaboutie
- Mesures sociales : pas de révolution sans attenter à la propriété privée
Aspects éducatifs
Aspects féministes
- Serge Kibal (historien) : « Un début de reconnaissance des femmes comme individus libres »
Aspects militaires
- Pourquoi et comment les fédérés furent écrasés
- La garde nationale : une force politico-militaire autonome
- Lyon, Marseille... tentatives avortées
Bibliographie
- Rougerie, Tombs, Thomas... le drapeau rouge à chaque page
Illustration : Le blanquiste Théophile Ferré, tirée de Bertall, Les Communeux. Types, caractères, costumes, Plon, 1880.