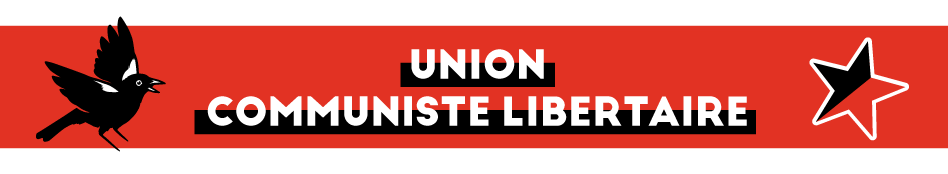Sur l’auto-organisation en Décembre 95
Sur l’auto-organisation en Décembre 95

« Encore faut-il s’entendre sur ce qu’est une AG de grévistes. Ce n’est pas une réunion d’information organisée par les syndicats, c’est bien un moment où chacun et chacune doit pouvoir se sentir suffisamment à l’aise pour parler, pour proposer, pour critiquer, pour décider. » Vingt ans plus tard, le point de vue de deux témoins des grèves de Décembre 95.
Alternative libertaire publie un extrait d’un long entretien paru sur Critique-sociale.info
Il y a vingt ans se déroulait l’une des plus puissantes luttes sociales qui ait eu lieu en France au cours de ces dernières décennies. En novembre et décembre 1995, des millions de grévistes et de manifestants se mobilisaient notamment contre le projet du premier ministre Alain Juppé de contre-réforme des retraites. [...]
Critique sociale : Quelles ont été les pratiques d’auto-organisation là où tu étais, auxquelles tu as participé ?

Christian Mahieux : En 1995, j’étais cheminot à la gare de Lyon, où je bossais alors depuis 19 ans. J’étais un des animateurs du syndicat régional CFDT, majoritaire à la gare de Lyon. Je donne ces quelques éléments, pour situer d’où je parle à propos de la grève reconductible de novembre-décembre 1995.
A la SNCF, ce n’est pas 1995 qui a marqué l’apparition (ou le retour) à des pratiques d’auto-organisation de la lutte. Neuf ans plus tôt, les trois semaines de grève de décembre 1986-janvier 1987 avaient permis d’imposer une rupture nette avec un système où la grève était devenue depuis longtemps l’affaire des syndicats, voire même des seules fédérations syndicales dès lors qu’on parlait de mouvement national.
La grève de 1986-1987 se situe dans une période de forte tension sociale : mouvement lycéen et étudiant contre la loi Devaquet, assassinat de Malik Oussekine par la police, grève des agents commerciaux de la SNCF puis grève des agents de conduite, qui se transforment rapidement en grève intercatégorielle sur l’ensemble de l’entreprise.
L’important acquis de 1986
De sa préparation à sa conclusion, ce mouvement est placé sous la responsabilité des assemblées générales de grévistes ; c’est un acquis important qui se retrouvera « naturellement » lors du démarrage de la grève 1995, avec une différence de taille : en 1986, si les collectifs CFDT-cheminots sont souvent à l’initiative du mouvement, les militants et militantes CGT combattent la grève dans ses premiers jours puis s’y insèrent de manière fort maladroite vis-à-vis des assemblées générales ; en 1995, du côté de la CGT la leçon a été retenue.
Cette pratique des assemblées générales est bien sûr essentielle. Encore faut-il s’entendre sur ce qu’est une AG de grévistes. Ce n’est pas une réunion d’information organisée par les syndicats, c’est bien un moment où chacun et chacune doit pouvoir se sentir suffisamment à l’aise pour parler, pour proposer, pour critiquer, pour décider.
En 1986-1987 comme en 1995, la quasi-totalité des AG au sein de la SNCF se font sur la base du collectif de travail : le dépôt, l’atelier, la gare, le chantier de ventes ou de manœuvre lorsqu’il s’agit de gros établissements. C’est à cette échelle qu’on a réellement des AG. Il ne s’agit pas de « meetings » où les porte-paroles des syndicats, fussent-ils des représentants ou représentantes locaux, donnent les nouvelles, appellent à reconduire le mouvement ou à l’arrêter, avant que la démocratie se limite à lever la main pour approuver ce qui vient d’être dit.
Multiples initiatives autogérées
C’est cette pratique de véritables assemblées générales où chaque gréviste peut aisément trouver sa place qui permet une appropriation de la grève par les grévistes ; d’où les multiples initiatives autogérées, parfois formalisées sous forme de « commissions » : pour la revue de presse quotidienne, pour les repas, pour les propositions d’actions, pour les liens avec les autres AG, etc. C’est de là que se feront « naturellement » les occupations de locaux durant le temps de la grève : il s’agit alors de se réapproprier collectivement les lieux de la grève, qui sont aussi ceux qui correspondent au champ de l’AG, au cadre connu car fréquenté quotidiennement depuis des années.
C’est ainsi qu’en novembre-décembre 1995, à la SNCF, beaucoup de directions locales ont été, soit expulsées, soit mises de côté, durant tout le mouvement ; des endroits stratégiques (commande du personnel roulant, postes d’aiguillage, guichets, etc.) ont été occupés dès les premiers jours de la grève. Tout ça s’organise à partir du collectif de travail, devenu collectif de grève ! Ça me parait important d’insister sur ce point : depuis 1986 et 1995, il n’est plus question pour les organisations syndicales appelant à la grève de combattre, du moins ouvertement, l’existence des assemblées générales ; mais trop souvent elles se transforment en caricature d’AG de grévistes, d’AG de travailleurs et de travailleuses décidant et coordonnant leur lutte.
« L’animation autogestionnaire des luttes consiste à organiser cette démocratie ouvrière, à la défendre »
Quelle que soit l’organisation politique à laquelle ils et elles se réfèrent, celles et ceux qui considèrent que la classe ouvrière n’est pas en capacité de définir et mener politique et luttes autonomes, ne supportent pas les vraies AG, représentatives, démocratiques, décisionnelles. A contrario, l’animation autogestionnaire des luttes consiste à organiser cette démocratie ouvrière, à la défendre : la pratique de l’Assemblée Générale quotidienne en est une des bases. Elle ne résout pas tout, d’autres points méritent une attention particulière, notamment la coordination du mouvement à l’échelle nationale, les liens interprofessionnels localement, etc.
Une des nouveautés de 1995 est la généralisation des liens directs entre salarié-es de secteurs différents : piquets de grève communs, délégations réciproques dans les AG, départs communs pour les manifestations, étaient devenus pratiques courantes entre cheminot-es, postier-es, enseignant-es, étudiant-es…
Responsabilisation individuelle dans la défense des acquis
Je ne sais pas si on peut parler d’auto-organisation à ce propos, mais la réussite de 1995 chez les cheminots et les cheminotes, le rejet massif du recul de l’âge de la retraite, se sont aussi appuyés sur le fait que nous avions su faire vivre une tradition inscrite dans la culture ouvrière cheminote : celle du rejet des collègues ne partant pas à l’âge « normal » de départ en retraite (50 ans pour les agents de conduite, 55 ans pour les autres). Cette responsabilisation individuelle dans la défense des acquis et la lutte contre le chômage des jeunes a été un élément déterminant d’une défense collective.
L’éclatement de la CFDT à l’occasion de cette grève ne peut être passé sous silence lorsqu’on parle d’auto-organisation. Passons sur la ligne majoritaire (de peu) dans la confédération qui aboutit au soutien au plan Juppé dès la mi-novembre ; mais dans l’opposition CFDT de l’époque, deux courants se sont rapidement dégagés : l’un a privilégié la bataille d’appareil, l’autre a fait le choix de soutenir la base des syndiqué-es qui, massivement, rejetait désormais ce sigle et cette organisation synonymes de trahison.
Et ce n’est pas par hasard si dans les syndicats SUD nouvellement créés dès janvier 1996, les désaffiliations de la CFDT les plus massives furent le fait de syndicats où depuis des années les désaccords avec la ligne confédérale étaient ouvertement débattus et partagés avec tous les syndiqué-es, et non traités par les seuls « dirigeants » du syndicat…
Critique sociale : A ton avis, qu’est-ce qui a manqué au mouvement ?
Christian : Dès le premier jour, les cheminots et les cheminotes ont vécu le mouvement comme une lutte ouverte à d’autres. Tant mieux si d’autres s’y joignaient, sinon il fallait au moins gagner sur nos objectifs. Le « contrat de plan État-SNCF » posait la question du service public, de la lutte pour l’emploi, de la désertification du territoire ; la défense des retraites et de la protection sociale renvoyait au refus de la régression sociale, qui plus est, dans un pays qui s’enrichit.
L’élargissement pouvait se faire sur deux plans :
- Le tissu interprofessionnel et associatif dans les départements, les régions, à travers le contrat de plan ; cela ne se fit pas.
- Les travailleurs et travailleuses des autres secteurs, pour la défense des retraites et de la protection sociale. L’extension s’est faite, mais limitée aux salarié-es en travail posté et roulant du secteur public. Le rôle des confédérations syndicales n’est pas étranger à cette faiblesse, la banalisation de la « grève par procuration » et le recours aux seules manifestations sans organiser une grève générale interprofessionnelle, ont pesé.
Et puis, comme souvent, une partie des animateurs et animatrices de la grève ne voulait pas franchir un cap supplémentaire, celui de la rupture politique avec le système en place, sous prétexte d’une absence d’alternative politique crédible à court terme… « l’alternative politique » étant conçue sous la seule forme de victoire électorale dans le cadre des institutions de la bourgeoisie. Encore la question de l’autonomie de la classe ouvrière, de sa propre capacité à construire son avenir, du débouché politique aux luttes dont elles sont porteuses par elles-mêmes…
Mais comme toujours, les responsabilités ne sont pas seulement « ailleurs ». Le rapport de forces créé par trois semaines de grève avaient permis des négociations locales sur le nombre de journées de grève non payées, mais aussi parfois des acquis plus importants : c’est ainsi que quelques jours après la fin de la grève, par la seule menace de remettre ça en gare de Lyon, nous avons obtenu l’embauche de 10 jeunes dont le syndicat a directement transmis les dossiers. Les patrons avaient peur, nous n’avons pas su garder cet avantage dans la durée…
Critique sociale : Quelles leçons de novembre-décembre 1995 pour les luttes d’aujourd’hui et de demain ?
Christian : Des leçons récurrentes : le besoin d’unité ouvrière, la nécessité d’un syndicalisme de lutte, indépendant, interprofessionnel, internationaliste, anticapitaliste, de masse, la bataille pour l’autonomie et la démocratie ouvrières, dans les luttes mais pas seulement… Mais plus que des leçons, savoir s’appuyer sur nos expériences, mémoires et acquis collectifs, tout en restant ouvert à l’inattendu !
ANTOINE : AUTOMNE 1995
À L’UNIVERSITÉ DE PAU,
UN SUCCÈS CONSTRUIT À CONTRE-TEMPS
Pendant le mouvement social de l’automne 1995, je suis étudiant à l’université de Pau. Pas (encore) syndiqué, j’ai pourtant participé activement, les années précédentes, à deux mobilisations marquantes : le rejet du projet CIP (contrat d’insertion professionnelle, vite renommé « SMIC-jeunes ») du gouvernement Balladur, en février/mars 1994 ; puis les grèves étudiantes contre le rapport Laurent en mars 1995.
Ces deux mouvements étudiants importants (plusieurs semaines de grève à chaque fois, près de la moitié des étudiants en manif) auront une influence cruciale sur le mouvement de l’automne 1995 à Pau. Pour beaucoup d’étudiants, cette grève qui s’étale de fin octobre à début décembre sera surtout perçue comme le troisième acte d’un même mouvement de contestation universitaire. Une continuité qui va permettre une mobilisation rapide et efficace, tout en éloignant peut-être les étudiants des enjeux nationaux interprofessionnels.
L’expérience des luttes
Quand les premières assemblées générales sont convoquées dans les couloirs de la fac de lettres de Pau, fin octobre 1995, elles ne surprennent guère que les « nouveaux », arrivés dans les amphis depuis quelques jours. Pour ceux qui ont déjà fréquenté cette fac plutôt remuante, rien de surprenant : les affiches, AG et manifs ont rythmé les deux précédentes années universitaires. Et dès les premières assemblées générales, les étudiants sont nombreux.
Il faut dire que le contexte palois est très favorable. Le campus a déjà vécu deux mouvements festifs et victorieux : début 1994, le SMIC-jeunes avait été abandonné par le gouvernement Balladur, et un peu plus tard, le rapport Laurent rangé dans les placards du ministère. Le souvenir de ces succès est encore très présent chez de nombreux étudiants qui sont de retour sur le campus à l’automne 1995.
Dès les premières AG, beaucoup retrouvent avec plaisir la même ambiance, les mêmes visages, et les mêmes pratiques de lutte : assemblées générales quotidiennes et souveraines, pas de comité de grève, pas de porte-parole permanent, pas ou peu de tracts syndicaux pendant le mouvement. Les rares délégués qui sont parfois désignés par l’assemblée générale (pour aller négocier avec le ministère, ou s’exprimer dans les médias) ont un mandat précis et très court. Il n’y a pas, en tout cas formellement, deux catégories de grévistes. L’assemblée générale se perçoit comme un groupe homogène et solidaire.
Des pratiques démocratiques
Des habitudes prises lors des mouvements de mars 1994 et mars 1995, sous l’impulsion des étudiants de la Coordination libertaire étudiante (CLE, affiliée à la CNT-AIT). Très actifs à l’université de Pau, les libertaires ne sont pas très nombreux : une trentaine de militants réguliers tout au plus. Mais dès 1994 et le mouvement contre le SMIC-jeunes, ils vont réussir à convaincre les grévistes de la nécessité de fonctionner selon leurs principes de démocratie directe. Des méthodes qui feront parfois grincer des dents dans les rangs des autres organisations étudiantes (l’UNEF-ID et l’UNEF-SE principalement), mais devant le succès de ces pratiques, il faudra bien faire contre mauvaise fortune bon cœur !
Ces pratiques de démocratie directe expliquent en grande partie le succès et la cohésion des deux mouvements précédents. Et en octobre 1995, plus personne dans les amphis ne songe à les contester. Avec un fonctionnement établi, des militants très impliqués et des centaines d’étudiants déjà bien rodés, la contestation s’organise très vite. Les revendications sont essentiellement locales : l’université de Pau vit une crise de croissance depuis quelques années et les moyens alloués ne suivent pas. Les premières assemblées générales exigent donc des postes d’enseignants, des postes de IATOSS (personnels non enseignants), ainsi que des subventions nécessaires à l’agrandissement des locaux.
Succès local, difficile coordination nationale
Les revendications s’appuient sur des faits établis (manque de moyens, de profs, de locaux) que personne ou presque ne conteste à Pau. Les étudiants se sentent concernés et le fonctionnement en assemblée générale, à défaut d’être toujours fluide, leur donne le sentiment de s’approprier le mouvement. Plusieurs revendications nationales s’ajoutent rapidement aux exigences locales, notamment la suppression de circulaires permettant aux préfets de contrôler l’assiduité des étudiants étrangers. Des tentatives de coordination nationale avec les autres universités en grève (notamment Rouen, très mobilisée) aboutissent plus ou moins, mais la mobilisation locale ne faiblit pas.
Mi-novembre, au moment même où les premières manifs contre les réformes Juppé s’organisent, le conflit à l’université de Pau est à son paroxysme. Le ministre François Bayrou dépêche un médiateur, Gérard Binder, afin de trouver des solutions. Après plusieurs jours de palabres, ce dernier finira par « lâcher » la promesse d’une dotation supplémentaire de 100 postes d’enseignants et 50 postes de IATOSS sur quatre ans. Le 29 novembre, un protocole d’accord est même signé entre Gérard Binder et l’assemblée générale (représentée par 14 délégués qui signent tous le document !).
Les étudiants grévistes de Pau votent malgré tout la poursuite du mouvement. A la fois pour maintenir la pression sur le ministère (qui doit encore confirmer la création des postes et l’allocation pour les travaux) et pour obtenir gain de cause sur les revendications nationales. Il y a aussi la volonté, plus ou moins exprimée en assemblée générale, de participer au mouvement interprofessionnel contre le gouvernement Juppé.
Étudiants et salariés solidaires
Sortir de l’université, ce n’est ni un tabou ni une nouveauté pour les étudiants de Pau. Lors du mouvement contre le rapport Laurent, en mars 1995, une centaine d’entre eux avait pris la route pour Toulouse afin d’interrompre un meeting du premier Ministre (et candidat à la présidentielle) Édouard Balladur.
En novembre-décembre 1995, la convergence des luttes était aussi à l’ordre du jour : les étudiants ont organisé des opérations péages gratuits, mais surtout ont occupé le centre de tri postal ou les voies de la gare. Ces deux dernières actions ont été menées en concertation avec des salariés de la Poste ou de la SNCF, dont certains représentants étaient venus aux assemblées générales étudiantes. La solidarité était bien présente et les préoccupations de politique générale également. Mais elles n’étaient pas le cœur des discussions en assemblée générale, ni le moteur de la mobilisation de la majorité des étudiants.
Le mouvement étudiant à Pau s’est arrêté peu avant Noël, comme la plupart des contestations sociales de l’automne. Son bilan local reste exceptionnel avec une mobilisation très forte des étudiants (jusqu’à 5.000 d’entre eux en manif pour 10.000 inscrits sur le campus !). Ses résultats sont également remarquables, avec l’obtention de 150 emplois et de crédits importants pour le fonctionnement de l’université. Ses liens avec le mouvement national étudiant, comme avec le mouvement national interprofessionnel, étaient bien réels même s’ils sont restés modestes, sans doute en raison d’un calendrier défavorable. Le début des grandes manifestations contre les réformes Juppé a en effet coïncidé avec la fin de la plupart des mouvements universitaires.
Parmi toutes les mobilisations étudiantes des années 1990, c’est pourtant celle qui s’est le plus rapproché des luttes des salariés, à travers des actions communes ou des manifestations générales. Chaque université en grève ayant fonctionné plus ou moins indépendamment, les expériences sont donc probablement très diverses. Vingt ans plus tard, en dépit de ce léger décalage avec les « grandes grèves » de 1995, ce mouvement étudiant reste une lutte passionnante, victorieuse et particulièrement formatrice. Pour de nombreux grévistes, ce combat de l’automne 1995 à Pau a été l’un des premiers pas d’un long parcours militant.