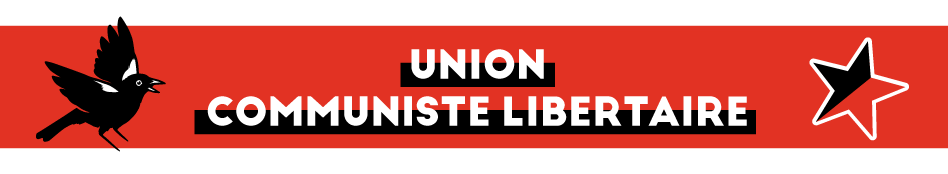L’action politique – politicienne, entendons-nous bien – relève parfois du funambulisme et exige un art certain. La période actuelle donne à voir le spectacle d’une équipe d’équilibristes, suspendus au-dessus du vide et balançant entre l’assèchement de la vie sociale et son embrasement.
Le meurtre atroce de Samuel Paty, enseignant d’histoire-géo- graphie, perpétré au nom de l’intégrisme islamiste, a suscité une intense émotion de l’ensemble de la société. Les instru- mentalisations de ce meurtre ont été quasi immédiates, multi- pliant les amalgames racistes. Une entreprise de division de la population que le gouvernement avait déjà entamé avec sa campagne islamophobe sur le « séparatisme ».
La gestion de la crise sanitaire a donné lieu à des mesures changeantes, partielles, contradictoires, parfois fantaisistes et pas toujours appuyées sur des preuves scientifiques. S’il est une constante, à l’heure de la deuxième vague de Covid-19, c’est que la gestion est d’abord économique et non sanitaire.
Le 17 septembre, le ministère de l’Intérieur présentait son nouveau schéma de maintien de l’ordre visant à « adapter » la gestion des manifestations en France ! Cette nouvelle doctrine se veut « plus ferme avec les auteurs de violences », mais aussi « plus protectrice pour les manifestants »… ce qui en langage policier revient à légitimer davantage de répression.
L’annonce d’une refondation du Haut-commissariat au plan a suscité bon nombre de réactions : à droite, on s’égosille face au retour d’un État jugé tentaculaire. À gauche, on déplore avec nostalgie le manque d’ambition de cette nouvelle institution qui ne serait qu’une pâle imitation de celle qui fut créée après la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, le Plan gaullien n’a jamais été un modèle de socialisme.
Plus d’un an après son arrestation en Bretagne en août 2019, le sort du militant anticapitaliste italien reste incertain.
Des gendarmes au lycée, des élèves enfermés, un proviseur muté, une institution en plein dérapage… mais ceux qui sont menacés de sanction, ce sont quatre profs qui ont contesté la réforme du bac ! Mutée d’office, exclue quinze jours, rétrogradé, blâmée... un scandale !
l y a cinq ans, Saint-Denis (93) était l’épicentre d’une révolte associant enseignantes et parents d’élèves. Une mobilisation historique, qui a contraint l’État à créer plus de 1 000 postes de professeurs des écoles. Comment l’alchimie a-t-elle pris ? Retour sur expérience.
Comment « bien réagir », lorsque des syndicalistes sont diffamés à l’aide de stéréotypes négrophobes et antisémites ? Dans le cadre d’une triste affaire, Solidaires-RATP a renoncé à une plainte en justice, et a préféré une argumentation accessible à toutes et à tous.
Dans son ouvrage, la brésilienne Joice Berth revient sur le concept d’« empowerment » qu’elle considère « vidé de son sens original et a perdu son pouvoir transformateur pour devenir une pratique individualiste, carriériste, récupérée par le néolibéralisme ». Et si l’enjeu était de nous réapproprier ce concept dans son ambition de transformation sociale ?
Une proposition de loi visant à renforcer le droit à l’interruption volontaire de grossesse a été adoptée par l’Assemblée nationale le 8 octobre. Cette loi constitue une avancée pour les droits des femmes, mais son parcours avant l’adoption finale est semé d’embûches, alors qu’elle est bien insuffisante. Seules nos luttes garantiront un droit effectif à l’interruption volontaire de grossesse.
Le ministère de l’Éducation nationale emploie plus de 70 % de femmes. Une femme sur cinq affirme avoir vécu des situations de violences au travail [1]. Les violences sexistes s’exercent dans toutes les sphères, dans le cadre de la famille certes, mais aussi au travail, notamment à l’école.
L’Âge du capitalisme de surveillance, le remarquable opus de la sociologue étatsunienne Shoshana Zuboff, est sorti le 15 octobre en français aux éditions Zulma. L’occasion de présenter cette autrice majeure et son œuvre.
Le deuxième référendum sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie qui s’est tenu le 4 octobre dernier s’est soldé par un échec du oui à l’indépendance. Cependant la perspective d’une rupture avec l’ordre colonial à encore de l’avenir.
Militante altermondialiste célèbre pour sa dénonciation du libre-échange, du système de la dette, de l’impérialisme, et de tous les dégâts sociaux et écologiques qu’ils entraînent en Afrique, Aminata Traoré a donné à Alternative libertaire son opinion sur la situation au Mali, la guerre au Sahel et la présence de l’armée française.
Quel rôle pour l’animal dans les sociétés humaines ? C’est est un point central de la réflexion écologique, où convergent deux questions éthiques majeures : celle de la souffrance et de l’exploitation animale d’un côté, et de l’autre, celle de l’élevage animal tel qu’il est déterminé par le capitalisme, où les paysannes et paysans sont tout autant des sujets exploités par un système. S’agit-il d’aménager l’élevage tel qu’il existe, de réduire son empreinte écologique, la souffrance animale autant qu’humaine ? S’agit-il au contraire de rompre entièrement avec ce modèle ? Et comment ? Alternative libertaire invite ce débat dans ses colonnes.
Quel rôle pour l’animal dans les sociétés humaines ? C’est est un point central de la réflexion écologique, où convergent deux questions éthiques majeures : celle de la souffrance et de l’exploitation animale d’un côté, et de l’autre, celle de l’élevage animal tel qu’il est déterminé par le capitalisme, où les paysannes et paysans sont tout autant des sujets exploités par un système. S’agit-il d’aménager l’élevage tel qu’il existe, de réduire son empreinte écologique, la souffrance animale autant qu’humaine ? S’agit-il au contraire de rompre entièrement avec ce modèle ? Et comment ? Alternative libertaire invite ce débat dans ses colonnes.
En octobre 1880, en Suisse, l’ultime congrès de la Fédération jurassienne sert de tremplin au lancement d’un nouveau courant révolutionnaire. Ce qui le distingue, alors, des autres écoles socialistes ? Sa stratégie insurrectionnaliste et son projet de société : le communisme libertaire.
David Rappe raconte la jeunesse militante de Bernard Pensiot (1948-2018), libertaire actif dans les régions parisienne puis, surtout, perpignanaise et lyonnaise. Il le fait à travers son engagement dans la lutte antifranquiste des années 1970-1975 ; le renouveau libertaire durant la mal nommée « transition démocratique » est aussi largement abordée. David Rappe, et Bernard Pensiot, nous rappellent que c’est l’extrême droite au pouvoir qui a organisé le rattachement de l’Espagne post-Franco au capitalisme de la fin du 20e siècle. En octobre 1977, les pactes de La Moncloa, rassemblant la quasi-totalité des organisations politiques et syndicales (hormis la CNT) en sont le point d’orgue.
Si l’économiste star des médias a rencontré nombre de critiques à sa droite, rares ont été les contradicteurs soulignant les limites cruciales de sa lecture du capitalisme et l’idéalisme de son analyse comme de ses propositions politiques. Respectivement sociologue et économiste, Alain Bihr et Michel Husson s’y attellent dans un essai incisif.
Dans ce premier recueil de textes à paraitre en français, Abdullah Öcalan, fondateur du PKK, aborde avec une grande clarté le concept de confédéralisme démocratique, lié à l’indispensable révolution des femmes.
Vingt-deux combattants internationalistes témoignent de leur engagement dans les unités YPG/YPJ au Rojava, racontent leurs motivations, leur périple pour rejoindre la région, leur apprentissage, leur quotidien, avec les combats ou au contraire l’attente interminable, leurs compagnons, leur difficile retour dans les « sociétés endormies ». « Nous étions des gens ordinaires, pas plus fous ou courageux que les autres. À un moment de notre vie, nous avons choisi de tout quitter, lucidement et sans fanatisme, pour combattre aux côtés des populations du Kurdistan syrien. »
La journée de mobilisation du 17 octobre a été historique. Des cortèges très fournis et dynamiques sur trois entrées dans Paris ont convergé place de la République. Mais là, la foule – 10 000 à 15 000 personnes – était inférieure aux attentes. La question est de savoir si cette déception démobilisera ou si la colère portera la réussite d’un acte IV. Car un acte IV est déjà envisagé.