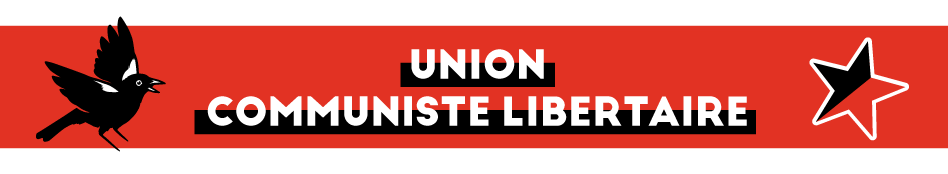Dossier 1917 : Octobre rouge (et noir) : L’assaut dans l’inconnu
Dossier 1917 : Octobre rouge (et noir) : L’assaut dans l’inconnu

Bolcheviks, anarchistes et SR de gauche fourbissent leurs armes. Le putsch est programmé pendant le IIe congrès panrusse des soviets, dans le but qu’il valide l’opération et lui confère sa légitimité. Mais ensuite ? Le Parti bolchevik, fer de lance de l’insurrection, conservera-t-il le pouvoir, ou le remettra-t-il réellement entre les mains du congrès ?

Après quelques semaines de tergiversation quant au meilleur moment pour déclencher l’insurrection, le comité central bolchevik a tranché : on renversera le gouvernement provisoire avant même l’ouverture du congrès des soviets, afin de le mettre devant le fait accompli. Ce timing est tellement nécessaire que le parti, en retard dans les préparatifs du putsch, manœuvre pour retarder de quelques jours l’ouverture du congrès.
Dans la nuit du 24 au 25 octobre 1917, l’opération de destitution du gouvernement provisoire, retranché dans le Palais d’hiver, est lancée. La forteresse Pierre-
et-Paul est occupée ; le croiseur Aurore, venu de Cronstadt avec toute une flottille d’insurgés, braque ses canons sur le palais ; les troupes rouges encerclent le bâtiment.
On est très loin de l’insurrection de juillet, populaire et brouillonne ; cette fois la préparation a été minutieuse – même si les cafouillages, à l’heure H, vont être nombreux – et les quartiers ouvriers n’ont pas été sollicités. Selon Trotski, seuls 25 000 soldats, marins et gardes rouges environ participent aux opérations, dirigées par un Comité militaire révolutionnaire (CMR) monté pour l’occasion.

Théoriquement issu du Soviet de Petrograd, théoriquement créé pour dissuader un coup réactionnaire du gouvernement provisoire, ce CMR groupe une soixantaine de militants. Parmi eux, une quarantaine de bolcheviks, une quinzaine de SR de gauche et six anarchistes : Iosif Bleikhman, Justin Jouk et Konstantin Akachev (de la Fédération anarchiste communiste), Efim Yartchouk et Bill Chatov (de l’Union de propagande anarcho-syndicaliste), et un certain Bogatsky (Union des anarchistes indépendants) [1]. Bleikhman estimera par la suite qu’environ 500 anarchistes ont participé aux opérations. Justin Jouk est à la tête d’un détachement de 200 gardes rouges ; Anatoli Jelezniakov de celui d’une unité de matelots [2] ; Bleikhman et Yartchouk participent au commandement de la flottille partie de Cronstadt [3] ; Akachev fera sécuriser le palais d’Hiver par deux batteries d’artillerie, après son investissement par les révolutionnaires.
Le congrès des soviets approuve le putsch
Le Palais d’hiver est cerné par les insurgés lorsque s’ouvre le IIe congrès panrusse des soviets, l’après-midi du 25 octobre. Signe de la radicalisation de la révolution, on compte désormais une majorité de bolcheviks, de SR de gauche et d’anarchistes parmi les 670 délégués venus de toute la Russie. Les modérés, déjà minoritaires, s’affaiblissent encore plus lorsqu’une partie d’entre eux quittent la salle pour protester contre le putsch en cours.
À 2 heures du matin, on annonce la prise du Palais d’hiver et l’arrestation du gouvernement provisoire. À 5 heures, une large majorité des congressistes approuvent cette destitution et le transfert du pouvoirs aux soviets.
La séance suivante n’est ouverte que le lendemain, 26 octobre, à 20 h 40, après une journée passée en conciliabules. L’assistance s’est enrichie d’un certain nombre de délégués absents la veille, pour la simple et bonne raison qu’ils participaient à la prise du Palais d’hiver. Parmi eux : trois délégués anarchistes : Jouk, Jelezniakov et Yartchouk.

Les débats se concentrent sur trois décrets solennels satisfaisant les aspirations populaires les plus fondamentales : le premier annonce l’ouverture de négociations de paix ; le second entérine le partage des terres par les paysans ; le troisième annonce... la constitution d’un nouveau gouvernement !
Sur les bancs des anarchistes et des SR de gauche, c’est la stupéfaction. Dans la journée, le Parti bolchevik a concocté un cabinet, qu’il soumet à présent à l’approbation du congrès. Par un joli tour de passe-passe sémantique, les mots « gouvernement » et « ministre » en sont absents : il s’agira d’un « Soviet des commissaires du peuple » (Sovnarkom), présidé par Lénine, et exclusivement composé de bolcheviks. C’est exactement le scénario que les anarcho-syndicalistes redoutaient. « Quel soviet de commissaires ? Qu’est-ce que cette invention ? s’exclame Yartchouk, provoquant quelque tumulte. Tout le pouvoirs aux soviets ! » [4]. Mais la majorité du congrès approuve sans barguigner.
Le lendemain, des autos sillonnent la capitale, lançant à la volée des tracts annonçant la composition du nouveau gouvernement. Voline, qui passe par là, en prend connaissance. Dans ses Mémoires, il racontera avoir été saisi d’un « sentiment compliqué de tristesse, de colère, de dégoût, mais aussi une sorte de satisfaction ironique ».
« Démagogues imposteurs », songe-t-il, ils doivent « s’imaginer qu’ils feront ainsi la révolution sociale ! Eh bien, ils vont voir… et les masses vont prendre une bonne leçon ! » [5]
Trois semaines de combats à Moscou
À Moscou, les choses ne se déroulent pas aussi facilement qu’à Petrograd, et l’insurrection prend une tournure plus populaire. Là aussi, les anarchistes se battent au coude à coude avec les bolcheviks, et un des animateurs de la FAC, Nikitine, y laissera la vie. Son camarade Gratchov, commandant du régiment de Dvinsk, très anarchisant, fera distribuer armes et munitions aux ouvriers de la ville. Mais il faudra au final trois semaines aux insurgés, avec des pertes assez lourdes, pour vaincre les troupes fidèles à Kerenski, retranchées dans le Kremlin et dans l’hôtel Métropole.
Au terme de la bataille, les anarchistes font partie du « camp des vainqueurs » d’Octobre. En conséquence de quoi, ils ont de nouveau pignon sur rue. La FAC se réquisitionne un nouveau QG – le manoir Ginzburg, dans le centre de Petrograd – ainsi qu’une imprimerie, celle du journal conservateur Jivoe Slovo, désormais interdit. Cela permet à l’organisation de lancer son propre quotidien : Bourevestnik (« L’Oiseau-tempête »). L’anarcho-syndicaliste Golos Trouda va également profiter de ces réquisitions [6].
Une nouvelle phase de la révolution commence donc. Pour les anarchistes, elle va consister à approfondir la révolution sociale, tout en contestant la tutelle gouvernementale croissante sur les soviets et les comités d’usine.
La « troisième révolution » va, très rapidement, devenir le mot d’ordre du mouvement.
Guillaume Davranche (AL Montreuil)
Au sommaire du dossier :
- Février-mars 1917 : Après les tsaristes, chasser les capitalistes
- Avril-mai : L’irrépressible montée vers l’explosion sociale
- Juin-juillet : Provoquer une insurrection ne suffit pas
- Août-septembre : La contre-révolution creuse son propre tombeau
- Octobre rouge (et noir) : L’assaut dans l’inconnu
- Novembre 1917-avril 1918 : Du pluralisme à la révolution confisquée. Quatre points de clivage :
- Épilogue 1918-1921 : Résistance et éradication
- Bibliographie : Pour découvrir la Révolution russe
- Retrouvez également le podcast (64 minutes) sur Spectremedia.org