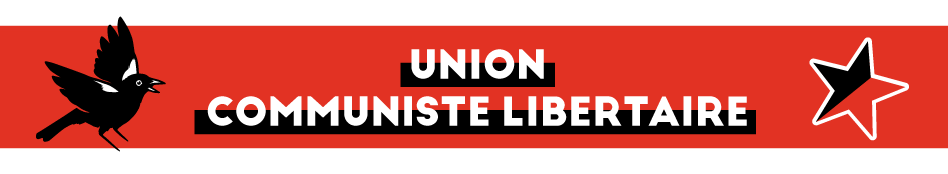La garde nationale, une force politico-militaire autonome
La garde nationale, une force politico-militaire autonome

Délaissant la plume pour la baïonnette, les révolutionnaires se sont fait élire officiers dans les bataillons populaires de cette « armée citoyenne » sans laquelle la Commune n’aurait sans doute pas eu lieu.
Le bras armé de la Commune de Paris, c’est la garde nationale. De quoi s’agit-il ? À l’origine, c’est la réserve de l’armée impériale, où sont versés les jeunes hommes non tirés au sort pour le service militaire. On distingue les gardes nationaux sédentaires – affectés à la défense locale – des mobiles (les « moblots ») qui peuvent monter au front aux côtés des soldats de ligne (les « lignards »).
L’état-major, qui méprisait ces réservistes mal entraînés, ne les a que peu sollicités au début de la guerre. Mais une fois l’armée impériale détruite à Sedan, il n’est plus resté, pour la défense du pays, que la garde nationale. Le gouvernement provisoire s’est empressé de la mobiliser en renouant avec la mémoire de 1792 et de « la patrie en danger ».
Ceux qui s’y enrôlent sont dotés d’un fusil, d’un uniforme, et indemnisés 1,5 franc par jour. Leur réputation d’indiscipline est due au fait que les gardes nationaux ne sont pas encasernés. Comme ils dorment chez eux et conservent des liens avec la population civile, chaque bataillon reflète la composition sociale de son quartier. Dans l’ouest de Paris, ce sont donc plutôt des bataillons bourgeois et, dans l’est, des bataillons populaires qui défendent les « fortifs » face aux Prussiens.
Un lieu de politisation
Après la capitulation, une bonne partie de la bourgeoisie a fui la capitale pour la province, renforçant le caractère prolétarien de la garde nationale et, pour des dizaines de milliers d’hommes, elle est devenue un lieu de sociabilité et de politisation. On y est, en moyenne, très hostile au gouvernement bourgeois qui a signé la capitulation. D’autant plus que les bataillons élisent leurs officiers, et ont placé à leur tête un certain nombre de révolutionnaires.
En janvier-février 1871, en assemblée générale, les délégués des bataillons fondent la Fédération républicaine de la garde nationale. Les « fédérés » se dotent bientôt d’un comité central d’une trentaine de membres. Forte, sur le papier, de près de 180 000 hommes – plutôt 40 000 dans la réalité –, la garde nationale est alors devenue une force politico-militaire indépendante du gouvernement et de l’armée régulière.
Après l’insurrection du 18 mars, le pouvoir est, de facto, entre ses mains. Le comité central de la garde nationale passe le relais au conseil de la Commune après les élections du 26 mars, mais continuera, jusqu’à la fin, à coordonner les bataillons fédérés.
Guillaume Davranche (UCL Montreuil)
Les autres articles du dossier
Crise prérévolutionnaire
- Les rouges prémices de la Commune
- Les tendances politiques qui vont animer la révolution
- L’AIT parisienne en ordre dispersé
Chronologie commentée
- 18 mars-28 mai : De la révolte montante à l’ultime barricade
Mémoire politique
- Quand les libertaires prenaient leurs distances
- Pour l’anarchiste Jean Grave, « La Commune légiférait, mais agissait peu »
- Gustave Lefrançais (1826-1901), entre communalisme et anarchisme
- La postérité internationale de l’idée de « commune »
Pouvoir populaire
- Commune, comités de quartiers, une dialectique inaboutie
- Mesures sociales : pas de révolution sans attenter à la propriété privée
Aspects éducatifs
Aspects féministes
- Serge Kibal (historien) : « Un début de reconnaissance des femmes comme individus libres »
Aspects militaires
Bibliographie
- Rougerie, Tombs, Thomas... le drapeau rouge à chaque page
Illustration : « Un fédéré », tirée de Bertall, Les Communeux. Types, caractères, costumes, Plon, 1880.